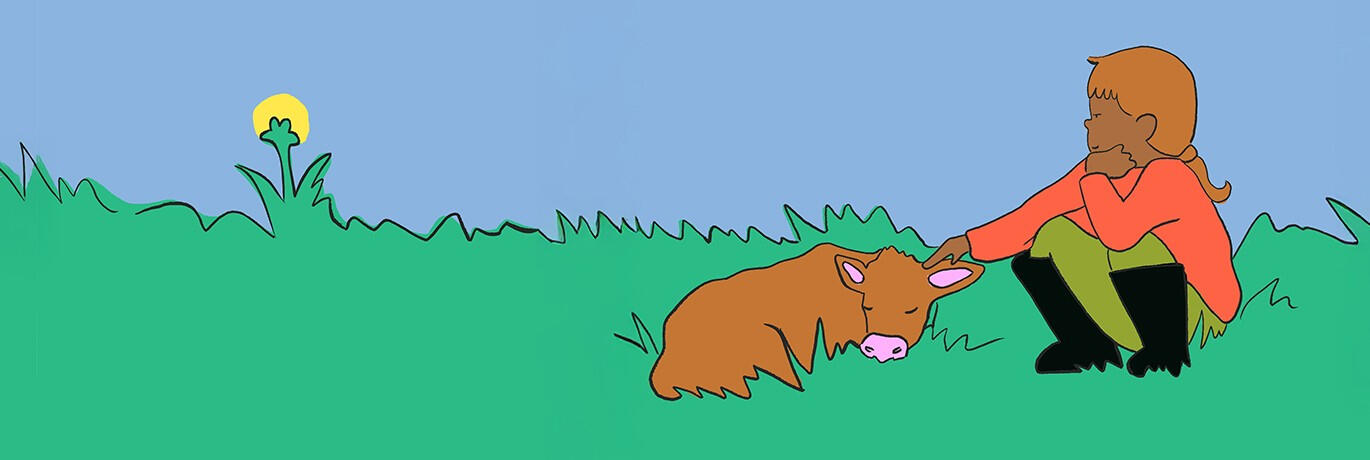
“Soil Sisters” : les femmes au cœur de l’agriculture européenne
Comment aborder de manière visuelle et accessible la question du genre dans la politique agricole européenne ? Pour répondre à cette question, le projet SWIFT piloté par Oxfam publie une bande dessinée nommée « Soil Sisters ». A travers le témoignage de 3 agricultrices, cette BD explore les défis auxquels les femmes et les personnes de genre divers sont confrontées dans leur vie quotidienne. La BD met également en lumière les solutions que les agricultrices mettent en place mais aussi les changements politiques nécessaires pour transformer le secteur agricole de l'UE vers la justice et l'égalité entre les genres.
Quels sont les défis auxquels les agricultrices font face ?
Elles rencontrent des obstacles lorsqu’elles veulent reprendre une ferme : le métier d’agriculteur·rice est vu comme un métier de couple et la ferme comme un capital qui sera transmis aux enfants, et en particulier aux fils. L’accès à la propriété est donc plus difficile pour les femmes et les personnes LGBTQIA+. Certaines agricultrices se retrouvent à travailler dans une ferme dont elles ne sont pas propriétaires, qui appartiennent à leur frère ou à leur mari.
Elles font énormément de travail non-reconnu : en plus de leur travail agricole, elles se retrouvent à devoir faire du travail administratif, des tâches ménagères, le travail du soin notamment s’occuper des enfants. Ce travail est non-reconnu et surtout non rémunéré. A cause de cela, elles ont moins de temps pour pouvoir se former et accéder aux espaces de pouvoir.
Elles font face à de nombreux stéréotypes : à cause des normes de genre, certaines pratiques sont présentées comme « masculines » ou « féminines ». Cela se joue dès l’enfance et influence les choix d’études des adolescent·es ainsi que la répartition des tâches sur les fermes. La capacité des femmes à s’en sortir seules est également régulièrement remise en question.
Le projet SWIFT : donner l’espace aux agricultrices pour témoigner de leurs réalités
Cette bande dessinée, illustrée par Jeanne Saboureault, a été réalisée dans le cadre du projet SWIFT. Le scénario a été co-écrit par Jeanne Saboureault, Louise Legein et Jessica Duncan . Il a été révisé par des chercheur·euses du projet SWIFT et les femmes d’ECVC.
Les objectifs du projet sont de lutter contre les inégalités de genre dans l'agriculture et les zones rurales, d'améliorer la représentation des femmes, des personnes LGBTQIA+ et des personnes migrantes dans les politiques de développement agricole et rural, et de démontrer la valeur ajoutée des « innovations menées par les femmes » pour les systèmes alimentaires. Il implique des chercheur·euses, des agricultrice·x·s, des organisations de la société civile (OSC), qui travaillent toustes ensemble pour atteindre ces objectifs.
L'un des aspects du projet consistait à analyser les politiques agricoles de l'Union européenne (UE) afin d'évaluer dans quelle mesure elles intègrent la dimension de genre dans leurs législations et budgets connexes actuels. Cette analyse a été réalisée à partir d'une étude documentaire et de dialogues politiques entre agricultrices, décideur·euses politiques, chercheur·euses et organisations de la société civile.
Les résultats de ce travail ont alimenté la bande dessinée. L'idée était de montrer que derrière des revendications politiques en apparence froides, il y a de vraies agricultrices, confrontées à une série de défis, qui s'organisent et dont la vie serait facilitée si elles étaient efficacement soutenues par les politiques publiques.
En partageant leurs histoires, nous montrons que les expériences personnelles sont politiques. Et que ce ne sont pas des cas isolés contrairement à ce qu'on pourrait parfois croire. De plus, chacun·e est concerné·e par les politiques publiques et, comme l'a dit Huong, notre collègue d'Oxfam au Vietnam lors de l'atelier SWIFT sur la budgétisation sensible au genre, les citoyen·nes sont des contribuables et ont le droit de contrôler et d'influencer la manière dont les budgets publics sont dépensés. Les politiques et la politique ne doivent pas nécessairement être inaccessibles et floues, elles peuvent appartenir à tout le monde et nous pouvons faire pression pour les rendre plus équitables.
Bien sûr, les décideuses et décideurs politiques ont la responsabilité finale de prendre en compte les réalités des personnes concernées par les politiques qu'iels élaborent.
Enfin, nous tenons à remercier les agricultrices qui ont pris le temps de partager leurs histoires, de donner leur avis sur la bande dessinée, ainsi que les chercheuses et chercheur qui l'ont relue, et bien sûr Jeanne pour sa patience et son engagement.
Pourquoi la politique agricole européenne (PAC) n’est pas équitable en termes de genre ?
Actuellement, l’agriculture européenne repose fortement sur le travail gratuit des femmes* et l’exploitation des travailleuses et travailleurs saisonniers. La transition vers des systèmes agricoles durables passe donc par la lutte pour l’égalité de genre.
La PAC ne tient pas compte des inégalités structurelles entre les hommes et les femmes.
De nombreuses interventions de la PAC ont un impact genré sans que le genre soit mentionné. En effet, à cause des normes de genre discriminatoires, d'injonctions de la société et des politiques agricoles du siècle passé, les femmes* ont moins accès à la terre, aux crédits, aux formations. Elles ont donc moins de chances de remplir les critères nécessaires pour recevoir les subsides de la PAC. Ce sont généralement les chef·fes d’exploitation qui sont éligibles pour ces aides, or, dans l’Union Européenne, 70 % d’entre elleux sont des hommes.
Les personnes LGBTQIA+ et les travailleur·euses migrantes ont également moins accès à la terre et sont également discriminées par les critères de sélection de la PAC.
Comment la prochaine réforme de la PAC peut changer la donne ?
Tenir compte des inégalités structurelles dans les interventions de la PAC, appliquer la budgétisation sensible au genre, garantir des prix justes pour les agriculteur·rices, assurer le respect des droits des travailleur·euses migrant·es, reconnaître le travail de toutes les personnes jusqu’ici invisibilisées. Tout cela contribue à lutter contre les inégalités dans la PAC.
Plusieurs documents produits par le projet SWIFT permettent de répondre à cette question :
